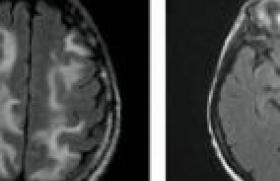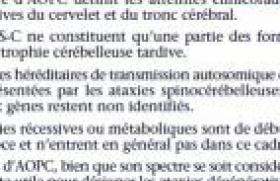Publié le 15 juin 2020Lecture 16 min
La neurologie en rose
Audrey BENEZIT*, Lesley SUIRO**, *Paris ; **Amiens

C’est à Toulouse, dans la ville rose, que c’est tenu cette année le 30e congrès de la Société française de neurologie pédiatrique, du 15 au 17 janvier dernier. Et c’est un coup double que nous vous proposons avec deux angles de vue sur cette actualité : l’un axé sur les pathologies neuromusculaires avec Audrey Benezit (Paris), l’autre sur les troubles dys et le TDAH avec Lesley Suiro (Amiens).
Actualités de l’amyotrophie spinale infantile (ASI)
• D’après les communications de S. Lefèvre (Paris) et de F. Audic (Marseille)
L'amyotrophie spinale infantile est une maladie autosomique récessive secondaire à une anomalie du gène SMN1 (délétion dans la majorité des cas), responsable de la dégénérescence progressive des motoneurones et entraînant un handicap moteur progressif avec répercussion respiratoire (insuffisance respiratoire restrictive), digestive (troubles de déglutition, troubles fonctionnels digestifs) et orthopédique (rétractions, scolioses, etc.).
La sévérité de la maladie dépend de la quantité de production résiduelle de protéine fonctionnelle SMN, issue de la traduction du gène SMN2. Ce gène SMN2 est une copie ancestrale du gène SMN1. Il subit un épissage alternatif de l’exon 7, entraînant la production d’une protéine SMN fonctionnelle en quantité bien moindre (10 % environ). Plus le nombre de copies SMN2 est important, plus la quantité de protéine fonctionnelle SMN est importante et moins la maladie est précoce et sévère. Les phénotypes cliniques sont classés en 4 types en fonction du stade moteur maximal atteint :
type 1 : n’a jamais pu ou a pu tenir sa tête ;
type 2 : a pu tenir assis ;
type 3 : a pu marcher ;
type 4 : forme adulte.
Fondamental
La protéine SMN s’exprime dès la vie foetale et de façon ubiquitaire. Son expression diminue fortement après la naissance. La protéine SMN joue un rôle essentiel dans l’assemblage des ribonucléoprotéines de l’épissage (snRNP) dans le cytoplasme, dans leur import au noyau où ont lieu les dernières étapes de maturation des snRNP au niveau de corps nucléaires (corps de Cajal). Un défaut de protéine SMN dans l’ASI entraîne un défaut d’assemblage des snRNP, et donc un défaut de maturation des ARN prémessagers. La protéine SMN est également impliquée dans le transport axonal des ARN messagers, la traduction locale et la formation de corps de Cajal. Le défaut de protéine SMN entraîne une anomalie de développement du muscle, organe endocrinien ayant une fonction autocrine et endocrine (coeur, poumon, tube digestif, etc.). Quel est donc le spectre de conséquences d’un défaut de protéines SMN pendant la vie fœtale ? Ce défaut ne se cantonnerait donc pas uniquement à une perte des motoneurones après la naissance. La physiopathologie de l’amyotrophie spinale n’est pas totalement élucidée. Sa meilleure compréhension est nécessaire afin d’optimiser la prise en charge des patients.
Clinique
En 2017, le traitement innovant nusinersen a obtenu l’autorisation de mise sur le marché pour le traitement de l’amyotrophie spinale infantile, d’abord pour les types 1 et 2, puis pour les types 3 en train de perdre la marche. Cet oligonucléotide anti-sens agit sur l’épissage alternatif de l’exon 7 du gène SMN2 et permet une augmentation de la quantité de production de protéine SMN fonctionnelle. Ce traitement limite la dégénérescence des motoneurones et permet donc aux nourrissons de poursuivre leurs progrès moteurs, en accord avec leur maturation cérébrale ; et il garantit au moins aux enfants de ne pas perdre davantage leurs capacités motrices.
Les neuropédiatres français prenant en charge ces patients ont exposé les résultats obtenus après au moins un an de trai tement par nusinersen (123 patients traités dont 34 type 1 et 89 type 2 sur 23 centres français). Les patients de moins de 2 ans (n = 30) ont un score HINE-2 (Hammersmith Infant Neurological Examination 2, score moteur) significativement plus élevé après un an de traitement qu’au début du traitement, mais utilisent davantage de soutien nutritionnel et ventilatoire.
Les patients de plus de 2 ans ayant bénéficié d’une MFM (mesure de fonction motrice) (n = 68) ont des scores globaux significativement plus élevés après un an, traduisant une amélioration motrice. Il n’a pas été retrouvé d’amélioration significative de ce score dans le groupe des 6-17 ans (n = 35). Aucun enfant n’a acquis la marche. Ces résultats mettent en valeur l’efficacité du nusinersen, avec un recul de 1 an de traitement. L’effet est d’autant plus important que l’enfant est jeune. Il modifie l’histoire naturelle des plus jeunes, c’est-à-dire des patients les plus sévères. Néanmoins, le handicap reste présent.
De nombreuses questions restent en suspens : que vont devenir les patients auparavant les plus sévères qui sont aujourd’hui traités ? Quelles seront les conséquences du défaut majeur de protéine SMN pendant la vie foetale chez ces patients qui seront traités après la naissance ? Allons-nous décrire un nouveau phénotype de patients ? La thérapie génique est disponible en France depuis quelques mois, nous attendons d’avoir plus de recul pour apprécier ses résultats. D’autres molécules sont à l’essai. Sera-t-il possible un jour de guérir complètement ces patients ?
Mise au point sur le syndrome de Guillain-Barré
• D’après les communications de P. Meyer (Montpellier) et de E. Cheuret (Toulouse)
Le syndrome de Guillain-Barré est une maladie rare, immunomédiée, précédée dans deux tiers des cas d’un épisode infectieux. C’est la cause la plus fréquente de paralysie aiguë (après la poliomyélite).
Il existe une grande variabilité clinique allant des formes classiques, parfois très frustres, aux formes atypiques type ataxique ou prédominant sur les nerfs crâniens. Il associe le plus souvent une paralysie progressive ascendante symétrique douloureuse avec aréflexie. Mais on peut retrouver également une atteinte des paires crâniennes (15 % des cas), une absence d’aréflexie (environ 10 % des cas), une dysautonomie, des troubles sphinctériens (rétention aiguë d’urine au début). On décrit également des formes frontières : le syndrome de Miller-Fischer ou l’encéphalite de Bickerstaff rentrant dans l’entité biologique du spectre des pathologies à anticorps anti-GQ1b.
Certains signes doivent remettre en question le diagnostic : atteinte asymétrique, troubles sphinctériens persistants, méningite associée et niveau sensitif. L’atteinte respiratoire, les troubles de déglutition et la dysautonomie font toute la gravité de cette pathologie. Les examens complémentaires comprennent :
une ponction lombaire pour rechercher une dissociation albuminocytologique, qui peut être absente si elle est faite précocement ;
un bilan infectieux : sérologies virales (HSV, CMV, EBV, etc.) et sérologies bactériennes (Mycoplasme pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Campylobacter jejuni, Borrelia burgdorferi, etc.) ;
le dosage des anticorps antigangliosides. Ils sont positifs dans un tiers des cas. Les anticorps anti-GM1 sont souvent associés aux cas secondaires à une infection à Campilobacter jejuni. Les anticorps anti-GM2 peuvent être retrouvés dans les cas secondaires à une infection à CMV. Les anticorps anti-GQ1b dans le Miller-Fischer ou l’encéphalite de Bickerstaff ;
un EMG pour caractériser l’atteinte : démyélinisante (70 % des cas en Europe), axonale ou syndromes associés.
La prise en charge consiste à hospitaliser l’enfant dans une structure proche d’une réanimation (en dehors des formes très bénignes), voire en réanimation en cas de détresse respiratoire, dysautonomie, troubles de conscience, progression rapide du déficit moteur (sur les 4 premiers jours d’évolution), atteinte des paires crâniennes. Il n’y a eu que très peu d’études portant sur les traitements spécifiques dans le syndrome de Guillain-Barré.
Les IgIV ou les plasmaphérèses sont indiquées en cas de perte de la marche. Il n’y a pas de supériorité d’efficacité décrite entre ces deux traitements. Les IgIV sont privilégiées pour des questions pratiques. Elles permettent d’accélérer la récupération et de diminuer la durée d’hospitalisation. En l’absence d’efficacité, il n’existe pas de recommandation thérapeutique : réaliser des échanges plasmatiques ? Refaire des IgIV 1 à 2 semaines après ? Patienter ? Les corticoïdes sont à éviter chez l’enfant. Il est important de prendre en charge la douleur (paracétamol, AINS, nalbuphine, morphine puis traitement des douleurs neuropathiques) et de débuter la kinésithérapie. En cas de trouble de déglutition, l’alimentation se fera par sonde nasogastrique. La durée de la phase de récupération est très variable, allant de 1 semaine à 28 mois. Les séquelles sont beaucoup plus fréquentes qu’on ne le pense : déficit moteur, fatigabilité, douleurs, troubles de sensibilité type paresthésies ou troubles de la sensibilité profonde, troubles du comportement, etc.
Le risque de séquelles est d’autant plus important qu’il s’agit d’une forme axonale et que la progression du déficit moteur a été rapide avec une hospitalisation pré coce. Il est donc recommandé de suivre le patient au minimum pendant 2 ans. Au décours, il n’y a aucune contre-indication à la vaccination. Il est recommandé de respecter un délai de 3 mois.
Développement cérébral et pauvreté
• D’après la communication de Y. CHAIX (CHU de Toulouse)
L'intérêt des neurosciences pour la pauvreté et le développement du cerveau est récent, il a débuté avec les travaux de M. Farah et depuis quelques années, le nombre de pu blications augmente. Les résultats de ces études montrent que la pauvreté crée de l’inégalité du fait de son impact sur le développement cérébral, d’où la nécessité d’informer les personnes travaillant auprès de ces enfants, et en premier lieu les pédiatres et neuropédiatres. Le développement du cerveau de l’enfant est le résultat d’une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux qui vont modifier le cerveau par la plasticité cérébrale, cette dernière étant d’ intensité variable selon la période, avec la notion de période sensible (figure 1).
Figure 1. Influence des expériences précoces sur le développement des fonctions cérébrales ; définition des périodes sensibles, d’après C.A. Nelson (Neural plasticity 2019).
La pauvreté est souvent définie de façon économique ou monétaire et si aux États-Unis, on parle de pauvreté absolue lorsqu’une personne vit avec moins de 25 $/j, on utilise, dans l’Union européenne, la notion de pauvreté relative en prenant comme référence le revenu médian de la population (1 710 €/mois ) . Si le revenu est < 50 % à ce dernier (donc < 855 €/mois), on considère que cet te famille est pauvre.
Cette pauvreté est particulièrement importante dans certaines zones comme l’Afrique centrale, l’Amérique centrale, etc. Dans l’UE, la France se positionne dans le tiers supérieur, donc parmi les pays où il y a le moins de personnes pauvres. Cependant, la situation est en réalité préoccupante puisque, depuis les années 2000, la pauvreté ne cesse d’augmenter avec actuellement 14 % de la population concernée, soit 8 millions d’individus.
Combien d’enfants sont dans cette situation ? Un enfant sur 5, selon l’article du Monde du 9 juin 2015, qui reprend une étude de l’Unicef. La pauvreté est pluridimensionnelle, et il convient de prendre en compte non seulement les conditions matérielles mais aussi les aspects psychologiques et développementaux, en se référant à Amatya Sen (prix Nobel d’économie en 1998) qui définit « la pauvreté comme non pas par ce que possède une personne, mais par ce qu’elle peut être, peut faire et peut devenir ».
Le critère retenu dans les études est souvent le NSE (niveau socio-économique ), car il intègre plusieurs facteurs objectifs (revenus des parents, leur niveau d’éducation, leur emploi et le lieu d’habitation) et subjectifs avec des questionnaires proposés aux parents. Il existe un lien entre NSE et santé mentale et physique : plus de risque de cancers , maladies cardiovasculaires, obésité et dépression, et plus particulièrement chez l’enfant, on aura davantage de retards de développement, de performances académiques et de scores aux évaluations intellectuelles plus faibles, ainsi que davantage de problèmes de régulation émotionnelle et comportementale.
Les études comme celle de M. Duyme (PNAS 1999 ; vol. 96 : 8790-4) ont montré l’impact du NSE sur le QI : 65 enfants placés puis adoptés entre 4 et 6 ans, revus ultérieurement à l’adolescence et évalués. On cons tate un gain sur le QI de 19,5 points si l’enfant a été adopté par une famille à NSE élevé, et de seulement 7,7 points si la famille a un NSE faible, donc un écart de 12 points. La pauvreté retentit aussi directement sur les apprentissages, comme l’a montré M. Farah en 2018 : lecture, orthographe et mathématiques.
Quels sont les facteurs explicatifs ?
• Sur le plan cognitif. Ce sont surtout les fonctions linguistiques qui sont impactées, ainsi que les fonctions exécutives et mnésiques comme la mémoire de travail et la mémoire épisodique.
• Sur le plan cérébral. Des études ont été publiées comme celle de J.L. Hanson en décem bre 2013 (PLoS One 2013 ; 8(12) e82806.) avec suivi longitudinal d’enfants de 5 mois jusqu’à 4 ans, répartis en deux groupes selon le NSE. La mesure du volume cérébral de substance grise est identique à 5 mois dans les deux groupes d’enfants, mais ce n’est plus le cas par la suite avec à 5 ans, où il existe une différence importante, puisque les enfants issus de familles à NSE bas ont moitié moins de volume de substance grise que les autres (figure 2).
Figure 2. Volume de substance grise en fonction du niveau socioéconomique (NSE), d’après l’étude de J.L. Hanson (PLos One 2013).
Plus finement, l’étude de K. Noble (Nat Neurosci 2018 ; 5 : 773-8) a évalué la surface corticale selon le niveau socio-économique des parents chez 1 099 participants âgés de 3 à 20 ans. Elle montre chez les enfants vivant dans des familles à faible NSE, une diminution significative de la surface corticale dans les régions frontales, temporales et pariétales qui sont attachées aux fonctions linguistiques, exécutives et de mémoire.
D’autres études montrent que le NSE module la qualité de la spécialisation hémisphérique (étude de R. Raizada. Neuro-image 2008 ; 40 : 1392-1401).
L’étude longitudinale de J. Kim-Spoon (Child Dev 2013 ; 84(2) : 512-27) sur 49 enfant s de 9 ans, revus à 24 ans pour effectuer une tâche de contrôle émotionnel, a montré que les adultes qui vivaient à 9 ans dans une famille à faible NSE ont à 24 ans une moindre activation du cortex préfrontal et une plus forte de la région amygdalienne. Les réseaux fronto-amygdaliens sont moins efficaces pour réguler les émotions, un lien étant observé avec le niveau de stress chronique évalué à 9 et 13 ans.
Comment comprendre l’impact de l’environnement ?
Deux grandes hypothèses :
Family stress model : les enfants des familles à faible NSE sont dans un environnement avec stimuli négatifs, donc soumis à un stress chronique qui impacte la régulation hormonale et, en particulier, supprime le rétrocont rôle négatif exercé au niveau thalamique sur la sécrétion de cortisol. Ces enfants présentent donc un taux de cortisol élevé en lien avec ce stress ;
par le biais de l’épigénétique, la modulation des gènes impliqués dans la production des facteurs de croissance cérébrale. J. Hanson (PLoS One, mai 2011) a montré ainsi que le volume hippocampique était plus faible chez les enfant s dans des familles à NSE faible.
Dans une famille pauvre, l’enfant est moins exposé à des facteurs positifs et moins stimulé, tout particulièrement au niveau du langage (vocabulaire, syntaxe, moins de langage adressé à l’enfant, utilisation moindre de la gestuelle, etc.). Ainsi, il a été montré qu’à 24 mois, le niveau de vocabulaire des enfants dépend du NSE des parents, également en corrélation avec le volume de langage adressé à l’enfant.
Ce constat posé, nous pouvons nous interroger : cette situation est-elle irrémédiable ou avons-nous des moyens d’action ? Diverses approches ont été étudiées :
une action sur les finances de la famille en apportant un supplément de revenus ; cependant l’effet semble faible avec un gain de 5 % soit pour le QI un point de progression, dans l’étude de G. Duncan en 2011 (Developmental Psychology ; 47(5) : 1263-79) ;
des actions ciblées sur le stress parental qui semblent positives pour les parents améliorent leurs compétences et leur niveau de dépression, mais l’impact sur l’enfant n’a pas été évalué ;
un programme d’intervention précoce auprès des enfants à partir du premier mois jusqu’à 3 ans, permettant de renforcer les interactions des parents avec leurs enfants : l’étude de C. Bann publiée en 2016 dans Pediatrics (137[4]), qui montre que les enfants dans les familles à faible NSE rejoignent sur l’échelle de développement ceux des familles à fort NSE.
En conclusion, l’impact de la pauvreté sur le développement cérébral de l’enfant est important, mais n’est pas une fatalité. Nous pouvons reprendre à notre compte la question de J. Luby : qu’est-ce qui serait plus important pour une société que de protéger le développement du cerveau de ses enfants ? Nous avons tous, pédiatres et neuropédiatres, à participer au débat, car il y a une urgence sociale.
TDAH : relations symptômes cliniques et scores à des tests normés
• D’après la communication de P. Bertin (Amiens)
Le diagnostic du trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) doit être posé par un spécialiste, mais l’évaluation initiale est faite par le pédiatre ou le médecin de famille qui orientera l’enfant si besoin (recommandations HAS, 2014). Les professionnels s’appuient non seulement sur l’entretien avec la famille et l’examen clinique de l’enfant, mais aussi sur des questionnaires (SNAP-IV, Conners, ADHD-RS, etc.). Ceux-ci sont un des éléments classiques de l’évaluation primaire d'une suspicion de TDAH : relations symptômes cliniques et scores à des tests normés. Ils comportent deux parties, l’une portant sur le versant hyperactivité/impulsivité (HI) et l’autre sur le versant inattention (IA), les deux présentations possibles du TDAH, en sachant qu’elles sont souvent combinées ou mixtes.
P. Berquin et son équipe (CHU Amiens, Inserm U-1105) ont comparé les résultats des questionnaires remplis par les parents et les enseignants à ceux de tests normés, cherchant une éventuelle corrélation entre la sévérité des symptômes rapportés aux questionnaires et les mesures plus objectives : tests psychométriques et tests informatisés mettant notamment en jeu l’attention soutenue, l’inhibi ion et la coordination visuomotrice. Cette corrélation a peu été étudiée dans la littérature (Rizzutti S et al. Arq Neuropsiquiatr 2008 ; 656(4) : 821-7).
Pour cela, 94 enfants TDAH ont été évalués (diagnostic selon les critères du DSM-V, âgés de 6 à 14 ans, 16 % de filles) à l’aide du SNAP-IV (questionnaire rempli par les parents et enseignants), de la CPT-II (Continuous Performance Task), de la Go/Nogo de la KiTAP ou de la TAP, de la capture attentionnelle (tests attentionnels informatisés), de l’échelle séquentielle du K-ABC 2 et des subtests similitudes et cubes du WISC IV. Les résultats montrent (après correction de Bonferroni, précaution statistique qui permet d’écarter les faux positifs) que seule la sévérité des symp - tômes HI évaluée par les parents (et non les enseignants) corrèle avec les scores de la CPT-II (p ≤ 0,002) (figure 1).
Figure 1. Corrélations entre l’âge des enfants et les scores au SNAP-IV donnés par leurs parents à l’inattention (A) et l’hyperactivité/impulsivité (B).
Corrélations entre les persévérations (C) et la variabilité des temps de réponse (TR) (D) obtenues par les enfants à la tâche d’attention soutenue de la CPT-II avec le score d’hyperactivité/impulsivité donné par leurs parents au SNAP-IV.
L’inattention évaluée par l’échelle SNAP-IV, qui ne corrèle pas de manière significative avec les tests informatisés, est probablement mal estimée par les parents et les enseignants. Les symptômes HI semblent donc mieux évalués cliniquement par les parents, et sont des indicateurs de sévérité plus robustes du TDAH. Enfin, les résultats confirment que, bien que modérée, on retrouve une évolution avec l’âge des symptômes HI (diminution) et IA (augmentation) similaire aux données de la littérature (Pingault JB et al. Am J Psychiatry 2011 ; 168(11) : 1164-70) (figure 2).
Figure 2. Représentation schématique de l’évolution des symptômes du TDAH à travers les âges. Extrait de : https://doctorlib.info/pharmacology/stahls-essentialpsychopharmacology-4/12.html
Au total, lors d’une consultation initiale pour une plainte attentionnelle, souvent en contexte scolaire, après l’entretien et l’examen cli nique, les questionnaires gardent une place intéressante dans l’évaluation de l’intensité des symptômes, essentiellement pour l’hyperactivité et l’impulsivité. Il reste cependant important pour le clinicien de penser à questionner la présence de troubles de l’attention dans la scolarité, mais aussi la vie quotidienne, y compris lors des activités extra-scolaires, sachant que le TDAH se manifeste de façon précoce, durable et dans toutes les situations.
À l’école : être différent, une véritable souffrance
• D’après la communication de C. ZIX (Forbach)
Le congrès s’est ouvert avec une première com munication de C. Zix, neuropédiatre à Forbach, qui a réalisé une enquête prospective sur 5 ans auprès d’enfants (scolarisés en élémentaire et au collège) consultant dans sa spécialité pour tous motifs ; il leur était demandé d’écrire une phrase sur ce qu’ils aimaient et une sur ce qu’ils n’aimaient pas. Ainsi, 155 enfants ayant écrit qu’ils n’aimaient pas l’école ont été retenus, et 44 ont, au contraire, déclaré aimer l’école ou leur maîtresse !
L’analyse des réponses des premiers a montré une écrasante majorité de garçons (84 %), dont la plupart présentaient des troubles d’apprentissages, et venaiennt pour la grande majorité de milieux sociaux peu favorisés. La classe où ils semblaient le plus en souffrance est le CM1.
Un exemple donné par C. Zix.
Évidemment, cette enquête présente un biais de sélection pui sque les enfant s vus en consultation présentent presque tous un trouble neurodéveloppemental (déficience intellectuelle, TDAH ou troubles d’apprentissages, mi graines, épilepsie, problématique psychoaffective, etc.).
Les résultats semblent toutefois montrer combien être différent peut mettre l’enfant en souffrance dans son école, alors même qu’une intégration de tous est préconisée. Les enseignants peuvent aussi souffrir d’une intégration des enfants différents vécue comme une obligation, ainsi le souligne C. Zix, avec des mots comme : « les médecins, les psys jugent de leur bureau, mais ce ne sont pas eux qui ont les enfants en classe ». Ce sujet est peu étudié, et certainement d’autres enfants peuvent ne pas aimer aller à l’école (enfants obèses, asthmatiques, etc.). Il serait certainement intéressant de mener une étude plus large, car malgré l’affirmation ministérielle que « 90 % des élèves sont heureux à l’école, idem au collège » (Le Monde, 2 septembre 2017), il semble que cela soit plus compliqué pour nos enfants « différents ».
Publié dans Pédiatrie Pratique
Attention, pour des raisons réglementaires ce site est réservé aux professionnels de santé.
pour voir la suite, inscrivez-vous gratuitement.
Si vous êtes déjà inscrit,
connectez vous :
Si vous n'êtes pas encore inscrit au site,
inscrivez-vous gratuitement :